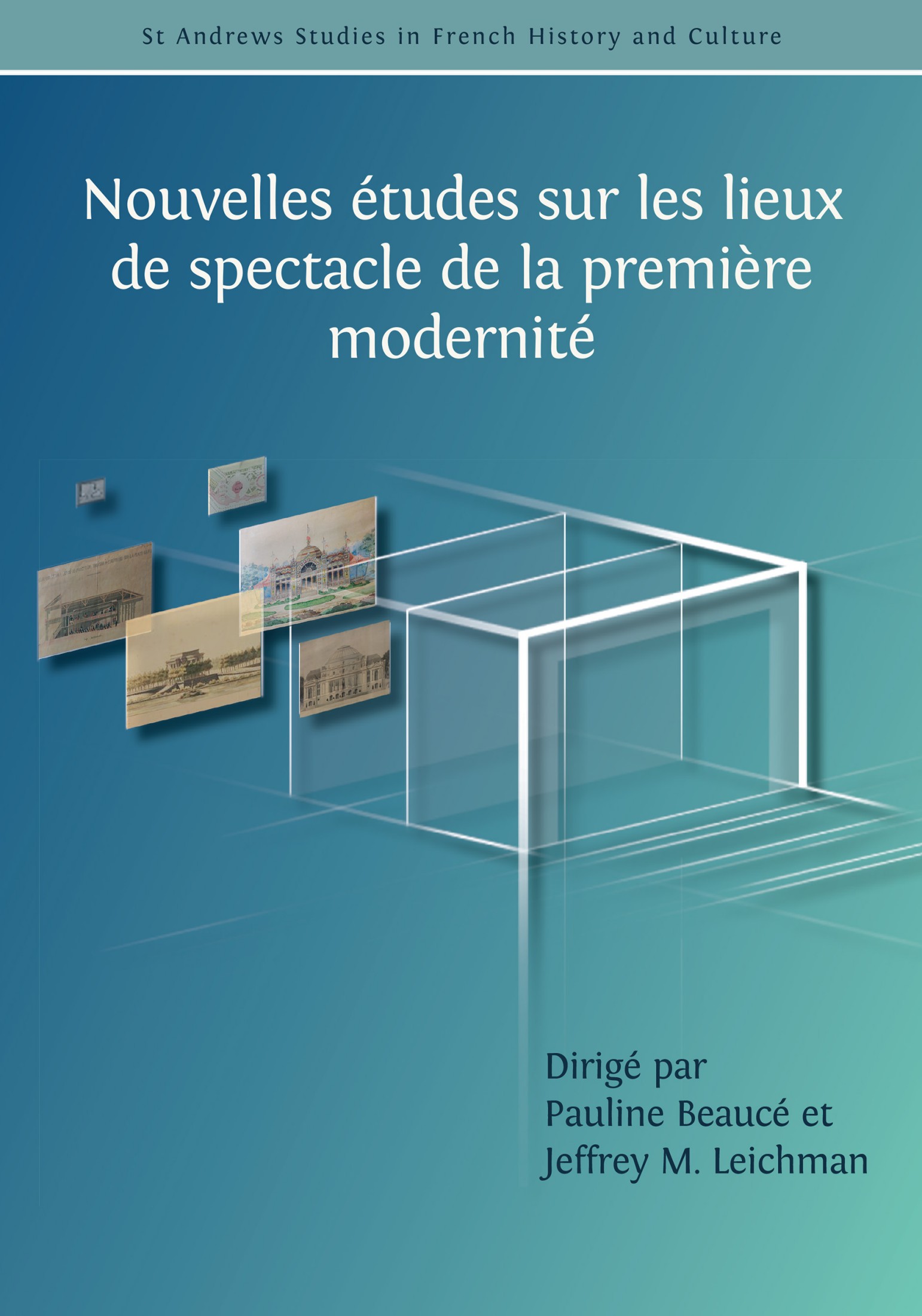9. Entretien avec Sandrine Dubouilh et Nicolas Patin : « Confronter nos savoirs » : retours sur l’expérience Montaigne in Game
Introduction ©2024 Pauline Beaucé et Jeffrey M. Leichman, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.09
Entretien ©2024 Sandrine Dubouilh et Nicolas Patin, CC BY-NC 4.0
Lors du colloque Repenser les lieux de spectacle de la première modernité (Bordeaux, 2022), l’historien Nicolas Patin (Université Bordeaux Montaigne/IUF) a animé, avec la chercheuse spécialiste de la scénographie et de l’architecture théâtrale, Sandrine Dubouilh (ENSA Paris Val-de-Seine/Université Bordeaux Montaigne), une session de « gameplay historique », dans le cadre du projet pédagogique Montaigne in Game. Ce dispositif consistait à utiliser la série de jeux vidéo Assassin’s Creed (Ubisoft), en jouant en direct et en expliquant le support vidéo-ludique comme un document à part entière. Montaigne in Game est une initiative qui a débuté en 2018 sous l’impulsion de José Luis de Miras. Elle a pour objectif de fédérer autour d’un objet relativement jeune, le jeu vidéo, les différentes disciplines scientifiques susceptibles de mettre en lumière le nouveau visage d’un média qui se confronte encore aujourd’hui à certaines réticences.
Deux espaces de spectacle ont donné lieu à des échanges entre les deux chercheurs et le public : le théâtre de Dionysos d’Athènes dans la Grèce classique de Assassin’s Creed Odyssey (Ubisoft, 2018) et l’Alhambra Music Hall de Londres de 1868 dans Assassin’s Creed : Syndicate (Ubisoft, 2015).
PB et JL : Qu’avez-vous pensé de cette expérience ?
SD : Quand vous m’avez proposé de prendre part à cette expérience, ma première réaction a été ambivalente, partagée entre d’un côté l’attrait pour une approche ludique de la recherche qui me semblait très stimulante, et de l’autre une connaissance de mes incapacités personnelles face aux jeux vidéo. Pour avoir observé longuement mes enfants jouer et même tenté d’y prendre part, j’ai plusieurs fois constaté la difficulté de me repérer dans ces espaces en mouvement, de cartographier les environnements créés pour m’y déplacer. C’est un rapport très singulier à l’espace, très éloigné de mes connaissances venues de mes études en architecture. Le fait de partager la séance avec Nicolas [Patin], qui jouait et se déplaçait en me demandant simplement de commenter, a donc bien évidemment soulagé cette crainte initiale. Mon sentiment, au-delà du plaisir suscité par cette séance de travail d’un genre particulier, est que c’est un bon exercice pour nous chercheurs et spécialistes de ces domaines. Le premier mot qui me vient à l’esprit pour qualifier cette expérience, c’est la vigilance. Cet exercice m’a semblé très exigeant, obligeant à visiter ses connaissances très rapidement, les confronter à ce que l’on voit, et soupeser leur validité. Cet exercice mobilise beaucoup, énormément, d’informations, dont on ne maîtrise pas tous les contenus. Le protocole proposé par Montaigne in Game est une bonne gymnastique et aussi une manière agréable et enrichissante de partager ce que l’on sait. Mais il m’a semblé que cette expérience appelle aussi une autre forme de vigilance, quant à nos réactions face à ces environnements voulus très réalistes. Cela oblige à garder l’esprit critique ouvert pour ne pas se laisser déborder par ces représentations.
Je crois qu’il ne faut pas porter de jugement péremptoire sur ces productions qui n’ont pas de vocation didactique. Ce que nous avons vu dans les exemples d’Athènes et de Londres, mélange des éléments probables voire avérés et d’autres historiquement faux. Tout coexiste. Dans différents domaines scientifiques, modéliser des objets disparus pour en comprendre les logiques et fonctionnements internes, poser des hypothèses, est bien entendu déjà assimilé, le colloque l’a d’ailleurs bien montré1. L’apport du jeu vidéo, outre l’interactivité permise par le jeu, c’est aussi le travail sur les ambiances et le mouvement. Montaigne in Game y ajoute la performance du commentaire direct en public et la possibilité de discuter, débattre, confronter nos savoirs et nos questions face à ces objets. Cela donne envie de s’imposer régulièrement des petites épreuves collectives de ce type. Le jeu est une bonne manière de nous mettre au travail ensemble. Les erreurs visibles dans ces modélisations sont aussi d’efficaces catalyseurs du désir de raconter ce que l’on sait et de rétablir les choses.
NP : J’ai beaucoup apprécié cette séquence de gameplay, car d’habitude, je réalise ce genre d’initiative soit devant le grand public, soit avec des collègues historiens. Le fait de bénéficier de l’expertise d’une spécialiste de l’architecture des espaces donnait un sens nouveau à la déambulation dans un « jeu ouvert », puisqu’elle était en mesure d’expliquer non seulement tel ou tel détail de l’environnement historique, mais bien aussi la logique générale du lieu et de sa reconstitution. Comme Sandrine le rappelle, les objectifs des jeux vidéo qui utilisent le passé sont avant tout ludiques et commerciaux. Mais la vraisemblance historique est devenue, au fil du temps, un argument artistique et pécuniaire non négligeable, qui explique que les grosses licences comme Assassin’s Creed investissent des efforts considérables dans l’authenticité, notamment dans les détails de l’open world. Pour Assassin’s Creed Origins par exemple, qui se déroule dans l’Égypte ptolémaïque, 200 consultants et experts ont été mobilisés. L’idée d’une telle conférence de « jouabilité live » est en quelque sorte de retourner le dispositif créatif, pour l’analyser comme un document, comme une représentation contemporaine, parmi d’autres, du passé. La question recouvre alors deux niveaux : une vérification de ce qui est vrai ou faux, qui, d’une certaine manière, n’est pas la plus importante puisque le jeu ne cherche pas à produire du vrai, mais uniquement des effets de réel ; un commentaire sur le produit culturel en tant que tel, qui permet de comparer les circulations avec d’autres supports imaginaires (romans, films, etc.). Dans le cadre d’un colloque sur l’architecture, un élément technique et non négligeable apparaît : s’il existe des modélisations efficaces d’espaces théâtraux financés par des laboratoires publics, un jeu de grand studio (un « triple A »), avec des budgets de plusieurs millions d’euros, et des possibilités techniques largement supérieures, font que les lieux virtuels sont souvent parcourus par les usagers des lieux (des PNJ – « personnages non-joueurs »), ce qui montre les lieux tels qu’ils sont habités et utilisés. De ce point de vue, la question de l’usage du bâti est donc posée, directement, sous nos yeux.
PB et JL : Identifiez-vous quelque chose d’unique dans ce que peut apporter une représentation interactive pour la recherche, par contraste à d’autres sources de fiction ou populaires, ainsi que des soucis que cela pourrait éventuellement soulever ?
SD : Il existe en effet des films d’époque dans lesquels sont révélés des fragments d’architectures théâtrales disparues. Je pense par exemple à l’introduction de Cyrano de Bergerac de Jean-Paul Rappeneau (1990), où se dévoile le théâtre du Marais, un de ces lieux du XVIIe siècle français dont il ne reste pas de trace tangible, ce qui accroît l’intérêt qu’on y porte. On peut supposer que les équipes de ces films ont travaillé avec des historiens compétents de manière à être au plus juste dans la reconstitution historique. Mais seuls sont construits les décors utiles pour le cadrage lié à chaque scène. Les environnements construits pour le jeu vidéo ne suivent pas du tout la même logique. Les éléments architecturaux deviennent des motifs pour créer à la fois de l’action (monter, courir, sauter…) et de la fiction (décor). Dans le cas d’Athènes, je trouve intéressant que le déplacement dans l’espace soit l’occasion de saisir certains rapports d’échelle, des distances, des hauteurs, des articulations entre les différentes localités. L’accès au théâtre m’a semblé particulièrement intéressant. On y perçoit l’espace ouvert, de plain-pied, sans barrière physique, au contraire de ce qu’on trouvera plus tard sous l’Empire. Mais dans le même temps, les usages de l’espace n’ont rien de réaliste ; comme le disait Nicolas, les personnages non-joueurs contribuent à animer l’image, à lui donner une échelle, mais ils ne font pas vivre ce lieu comme il devrait l’être et c’est aussi une différence notable avec les films qui ont vocation à être réalistes dans les usages précisément. J’aime bien par exemple exploiter en cours certains extraits des Enfants du Paradis de Marcel Carné (1945) pour montrer la densité des spectateurs debout au balcon dans les théâtres du boulevard. Dans ce jeu vidéo, le théâtre n’est utilisé que comme une localité susceptible de servir l’action du jeu lui-même.
Il n’était pas question non plus de « visiter » simplement ces théâtres comme peuvent le proposer des restitutions numériques en VR telle que celle réalisée par Paul François pour le théâtre de marionnettes de la Foire Saint-Germain où l’on peut arpenter la salle, la scène, tester aussi la relation scène-salle en maîtrisant ses propres déplacements. Dans le cas du jeu vidéo, on se déplace certes, mais selon des logiques qui n’ont rien de la visite-découverte même si Montaigne in Game favorise cette possibilité. Pour avancer et me permettre de voir différents espaces, Nicolas a été contraint de jouer et ce faisant d’occire plusieurs personnages ! On voit ici le principe de détournement de la fonction ludique initiale du jeu.
Plus sérieusement, tous ces outils sont utiles et intéressants, mais aucun n’est suffisant en soi. Si je fais une maquette physique en volume d’un théâtre disparu, j’accède à beaucoup d’informations géométriques et spatiales. Si je regarde un film historique, je vois sur un écran des plans qui mettent en situation des espaces et des corps ainsi que des ambiances. Dans le jeu vidéo, selon des codes graphiques propres à chacun de ces jeux, je peux déambuler dans ces espaces, rarement selon des usages réalistes et les lieux représentés sont des prétextes au jeu. Dans la modélisation en RV, je conjugue les effets de la maquette physique et du jeu, mais ces objets sont très difficiles et coûteux à produire. L’important est de pouvoir exploiter tous ces outils dans les limites de ce qu’ils sont.
PB & JL : Quelle place pourrait prendre le jeu vidéo dans tes enseignements en arts du spectacle et en architecture ?
SD : Si je repense au cas du théâtre d’Athènes dont il est précisé « sous Périclès », ce qui est un détail important pour le situer et pour envisager sa morphologie, j’ai apprécié que soit restituée l’hypothèse défendue notamment par Jean-Charles Moretti d’un théâtre trapézoïdal en bois, montrant donc ici l’attention des concepteurs du jeu à des connaissances archéologiques récentes, ce que bien des ouvrages d’histoire du théâtre n’ont malheureusement pas intégré, restant focalisés sur le modèle épidaurien. Je peux donc doubler dans mes cours la présentation des dessins de Jean-Charles Moretti de ce type de vue qui nous permet par exemple d’être dans l’orchestra ou dans les gradins du koilon. Mais la skènè en revanche pose problème, car certains détails semblent peu vraisemblables. Il manque aussi le lien au sanctuaire et au temple. Au-delà des différentes parties du théâtre et de leur degré de véracité, je pourrais exploiter un extrait de gameplay pour aiguiser le sens critique des étudiant.e.s et leur capacité à observer, les faire s’interroger sur la modélisation numérique et son caractère plus ou moins illusionniste, ceci en particulier pour les étudiant.e.s en architecture, qui manipulent beaucoup ces images et qui, pour certain.e.s, s’orienteront peut-être vers la production d’images numériques pour le jeu ou le cinéma par exemple.
Le cas de l’Alhambra Music Hall de Londres était très intéressant aussi, avec son promenoir, notamment une impression de fumée même si on ne montre pas la tabagie qui sévissait dans ces lieux, ce qu’on ne peut pas exprimer sur des vues géométrales. Mais paradoxalement, les proportions semblaient aberrantes et surtout la représentation de la scène et des décors scéniques était très maladroite, schématique certes mais sans aucun effort de modélisation du plateau traditionnel avec ses plans, costières, cintres etc., pourtant très connus.
Comme je l’ai dit précédemment dans la comparaison avec le film, ces représentations posent aussi question quant à la place des usagers. Ni à Athènes ni à Londres nous ne sommes face à des spectacles sur ces scènes. Il y a des PNJ, mais hors situation de spectacle, notamment à Athènes. Mais en même temps, il est intéressant que ces PNJ soient là pour rendre le lieu plus dynamique et contribuer, notamment à Londres, aux ambiances où, à défaut de voir un spectacle, on peut ressentir ce qu’il se passe dans la salle, la mobilité des spectateurs entre autres.
Il est aussi intéressant que ces deux espaces numériques permettent de confronter deux types de lieu de spectacle que tout sépare, l’un ouvert, l’autre clos par exemple. Malgré toutes les réserves que l’on peut formuler sur le degré de fidélité à l’histoire, avec des moyens plus faciles à partager que les vues géométrales (je pense ici aux étudiants en arts du spectacle), moins rares que les modélisations en RV à des fins scientifiques, plus appropriables que des plans de caméra où l’on ne décide pas du cadrage, on peut accéder à de nombreuses informations, toucher au sensible de la pratique de ces spatialités (ce qui manque aux étudiants en architecture).
Avec le recul, je constate aussi que si le jeu vidéo peut éveiller doute voire mépris dans le monde de la recherche, sa façon de flirter avec le réalisme, de mélanger le vrai et le faux, le rend moins littéral que certaines productions scientifiques qui ferment définitivement les connaissances sur des domaines pourtant toujours en mouvement, ce que je rencontre sans cesse dans la recherche sur les lieux de spectacle où l’on a tendance à tout simplifier, à fixer dans quelques modèles types. À ce titre, la versatilité du jeu vidéo est aussi un bon outil pour relativiser notre propre rapport au savoir.
1 Plusieurs communications ont donné lieu aux articles et brèves de méthodologie du présent ouvrage.