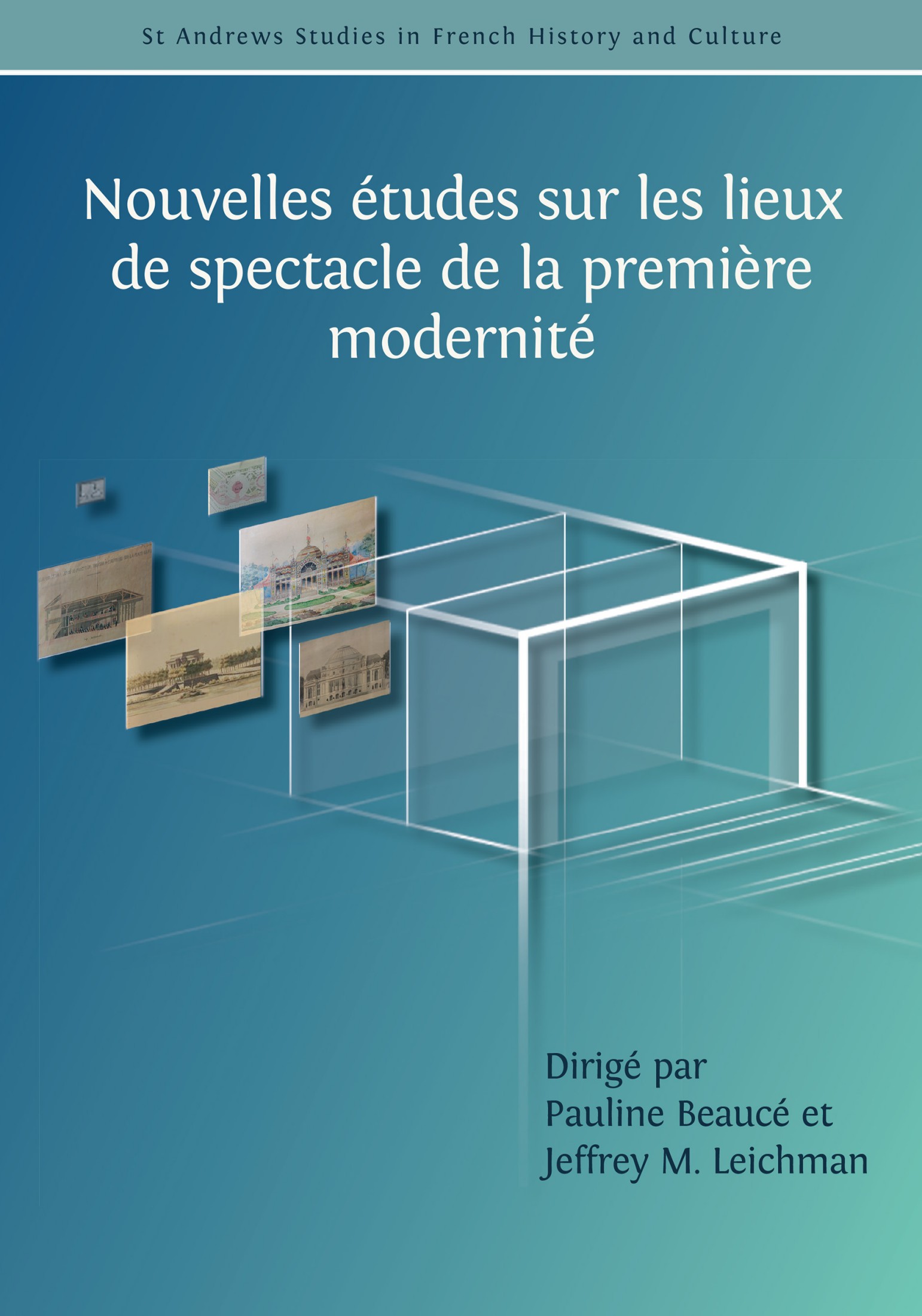Introduction :
Des archives au virtuel (aller-retour)
©2024 Pauline Beaucé et Jeffrey M. Leichman, CC BY-NC 4.0 https://doi.org/10.11647/OBP.0400.00
L’histoire des lieux de spectacle n’est pas, comme on l’envisage encore trop souvent, un catalogue de solutions architecturales et scénographiques. C’est l’opportunité d’entrer dans des processus complexes, aux intervenants multiples. C’est [...] une autre façon de parler du théâtre.
Sandrine Dubouilh, « Le lieu théâtral comme objet de recherche : enjeux, méthodes et perspectives », Horizons/théâtre, no 15, 2022, p. 25.
L’exergue pointe un désir commun aux études ici rassemblées, d’écrire l’histoire des lieux de spectacle de la première modernité en sondant de nouvelles perspectives historiographiques. Notre objectif est de relever un défi épistémologique autour de la notion de virtuel pour la recherche en histoire du théâtre, ce qui engage des formats différents de réflexion (entretiens, articles multimédia, brèves de méthodologie, exposition) afin d’ouvrir la discussion aux chercheurs et chercheuses en littérature, musicologie, histoire, études théâtrales, histoire de l’art, informatique, architecture et sciences du numérique. Le titre que nous donnons à cette introduction résume à la fois la méthode et la volonté d’un renouveau interprétatif ancré dans le concret des archives multiformes, en partant d’hypothèses rendues possibles par des perspectives contemporaines – qu’il s’agisse d’outils techniques ou de revalorisation d’objets autrefois jugés mineurs ou sans intérêt – afin de situer le lieu de spectacle aussi largement que possible au carrefour des imaginaires et de ses usages pratiques. Vu sous cet angle, le lieu de spectacle est avant tout la conjugaison du tangible (l’environnement bâti urbain, salles, décors, et leurs traces matérielles) avec le momentané (la performance, les évolutions techniques, politiques et artistiques). Cet ouvrage témoigne de l’essor des recherches sur l’histoire matérielle des spectacles et sur les considérations autour du virtuel qui orientent désormais les travaux d’une large communauté scientifique, allant des doctorants aux professeurs chevronnés. Il intègre aussi une réflexion sur la transmission des savoirs car ces recherches ne sont pas déconnectées d’enjeux pédagogiques. La diversité des objets de recherches, des méthodes et des résultats rassemblés éclairent non seulement la question des lieux mais aussi inévitablement et expressément maints autres aspects de l’histoire du théâtre.
***
Le virtuel est d’abord ce qui est en puissance, ce qui reste à l’état de potentialité, de possibilité, sans jamais être actualisé, définition qui place le virtuel dans le giron de l’imaginaire. Ce terme a aussi pris un sens propre à son usage dans le monde informatique au XXe siècle, renvoyant alors à l’univers du numérique qui se déploie comme un double ou un prolongement du réel. C’est ce sens qui prime dans l’expression « réalité virtuelle », une réalité non pas en puissance ou à l’état de possibilité mais simulée par la perception de présence physique de l’utilisateur dans un environnement créé informatiquement. La réalité virtuelle (RV) n’a pas encore réalisé le potentiel initialement projeté de recréer le monde dans l’espace informatique (pensons aux déceptions du métaverse), mais ce dispositif produit néanmoins des effets notables, surtout l’impression immanquable d’être immergé dans un espace différent de celui où se trouve son corps physique, une capacité qui rend la RV particulièrement utile pour l’étude des lieux historiques. Mais bien au-delà d’une nouvelle modalité numérique, le virtuel est aussi un élément propre à l’architecture (projets papiers) et à la performance théâtrale elle-même. La scène de théâtre se caractérise par sa virtualité, au carrefour de toutes les potentialités qui la composent (texte avant son passage à la scène par exemple) et son rapport complexe au réel. Les chapitres suivants cherchent à promouvoir la réflexion autour des concepts et des procédés du virtuel, dans toute leur polysémie, en même temps qu’elles enrichissent l’histoire matérielle des spectacles. Ce volume représente ainsi une volonté de déployer la plurivocité du virtuel contre une tradition de cloisonnement disciplinaire, tant la diversité des considérations qui déterminent la réalisation du lieu de théâtre excède les limites factices de l’organisation académique. Il s’agit d’étendre les domaines de recherche, de mobiliser des expertises diverses et de bousculer les habitudes intellectuelles afin de réévaluer les sources et de faire dialoguer les époques entre elles.
Des échafauds simples ou complexes à la fin du Moyen Âge aux théâtres-temples et espaces hybrides des Lumières en passant par les jeux de paume et autres lieux d’enveloppes diverses dédiés à la performance, les espaces du spectacle ne sauraient se réduire à quelques modèles1. L’intérêt que leur porte la recherche en histoire de l’art et du théâtre n’est pas neuf2, mais depuis l’avènement du numérique à la fin du XXe siècle, il s’accompagne de nouvelles potentialités. Aux recensements et aux méthodes d’analyse et de restitutions traditionnelles, s’ajoutent les outils offerts par les technologies numériques (modélisation, infographie, réalité virtuelle, les systèmes d’information géographique ou SIG) et les usages nouveaux (médiation culturelle, jeux vidéo, création artistique3). La visualisation informatique, désormais au cœur de la transmission du savoir dans beaucoup de domaines, permet non seulement de voir, d’analyser et de situer les espaces mais aussi de faire l’expérience sensible des lieux du passé, offrant des perspectives pédagogiques importantes. Les attraits des nouvelles technologies pour réinvestir l’étude du passé ne sont cependant pas neutres, et appellent même à une vigilance particulière de la part du chercheur, car l’illusion perfectionnée convainc sans besoin de raisonner et la perspective d’une histoire fausse, voire révisionniste, demande une méthode exigeante4. Dans la mesure où l'une des spécificités de l'outil informatique est de produire des rendus visuels réalistes sans besoin de fondement dans la réalité, la recherche se doit de déployer ces outils avec le même soin appliqué aux interprétations visuelles d’autrefois. C'est une leçon livrée au début de l’ère des ordinateurs personnels par le travail de John Golder, qui s’est tourné vers l’infographie afin de déjouer des erreurs dans la compréhension du théâtre du Marais. Dans ce cas, il s’agissait de questionner un mode d’autorité visuelle plus ancien : les dessins réalisés par des architectes à base d’informations incomplètes, mais considérés véritables pendant des années à cause de leur exécution soignée5. Quarante ans plus tard, les avancées graphiques rendent d’autant plus pertinent le point principal de Golder, à savoir que la documentation historique, la collecte des archives et leur analyse doivent fonder toute représentation visuelle des lieux de spectacle du passé – et surtout les images numériques.
Que reste-t-il des lieux de spectacle de la première modernité ? Dans quelques cas, il reste un bâtiment rénové dont on conserve encore des éléments (pensons aux décors du théâtre public de Feltre, en Italie, étudiés par Raphaël Bortolotti), dans d’autres des vestiges, parfois menacés de ruine complète (le cas du « Vieux Théâtre » de Morlaix analysé par Rafaël Magrou et ses étudiantes). Mais souvent ne subsiste que peu voire aucune trace matérielle, lacune à combler par les nombreuses sources qui sont à disposition pour comprendre, imaginer et restituer ces espaces avérés ou hypothétiques intimement associés à l’activité du spectacle. La première qui vient à l’esprit, l’iconographie (plans, dessins, peintures, gravures, etc.), revêt un caractère paradoxal : déceptive parce que souvent inexistante, partielle (un plan sans échelle, un dessin abîmé, un croquis isolé6, etc.) ou partiale (par exemple une peinture qui reflète le point de vue de l’artiste ou une restitution postérieure), elle n’en reste pas moins un puissant catalyseur et une source majeure pour l’histoire matérielle du théâtre7. Une partie de l’intérêt de ces images réside dans les difficultés interprétatives qu’elles soulèvent : quid d’un plan dont on ne sait quel état il présente, d'une esquisse nimbée de mystère, d’une gravure sans légende, d’une restitution numérique éblouissante mais peu documentée ? Les images, quand elles existent, ne sauraient se suffire à elles-mêmes pour analyser ou restituer un espace théâtral dont les « dimensions » comprennent aussi bien sa taille que ses usages et son importance sociale8. Depuis longtemps la recherche scientifique s’appuie sur d’autres sources, parfois plus arides (devis, contrats, archives administratives et policières, textes et musiques, description dans des sources textuelles, etc.). La méthodologie qui traverse les études rassemblées dans ce livre s’articule autour de la relation complexe des archives au virtuel, et ce même lorsqu’il n’est pas question d’appliquer des techniques de visualisation numérique, tant leur omniprésence dans le monde habité par les chercheurs contemporains les établit comme une finalité à tout moment possible. Faire résonner l’histoire des lieux de spectacle avec la notion de virtuel, loin de mettre de côté la question des sources au profit d’une réflexion sur les technologies, place au contraire la focale sur les archives, leur pluralité, la complexité de leur analyse à tous les niveaux de la recherche sur les lieux, en leur donnant une épaisseur historique qui dépasse une représentation visuelle isolée.
***
Ce volume s’inscrit – par son interdisciplinarité, l’empan chronologique couvert, le resserrement géographique principalement sur l’espace francophone, et les problématiques exploratoires choisies – dans le sillage de projets collectifs internationaux qui ont permis de recenser des salles oubliées dans les villes de province en France (ANR THEREPSICORE9), de restituer des théâtres disparus (Visualising Lost Theaters10), de recréer une soirée théâtrale dans un théâtre forain du XVIIIe siècle pour explorer les sociabilités à l’œuvre (VESPACE), d’expérimenter la réalité virtuelle pour la pédagogie (ARCHAS), ou encore d’interroger la manière dont l’outil virtuel permet de mettre au jour des lieux qui n’ont jamais abouti, en marge des théâtres institutionnels (The LAB 18-21, RECREATIS, Virtual Theaters in the French Atlantic World11). Ces projets et travaux récents en histoire du théâtre, dont les exemples cités ne sauraient être exhaustifs12, proposent des solutions inédites aux questions difficiles posées par l’étude des lieux de spectacle de la première modernité auxquelles le présent ouvrage entend en partie répondre : comment travailler sur des lieux pour lesquels il semble ne rester aucune source visuelle ou matérielle ? Quelles sont les précautions et les méthodes à mettre en œuvre lors de restitutions virtuelles d’espaces du passé ? Quels sont les usages de ces modèles ? Quelle place donner au virtuel, à ce qui n’est resté qu’à l’état de potentialité, dans le discours historique ? Question qui fait écho aux études de l’architecte Yann Rocher et des historiens Pierre Singaravélou et Quentin Deluermoz sur l’histoire des possibles13.
Ce volume invite à repenser les lieux de spectacle de la première modernité à l’aune d’une virtualité de plus en plus présente dans notre pensée et notre monde. Les études rassemblées partagent une même méthode, malgré les écarts sensibles dans les ressources mobilisées et les objectifs visés : toutes se fondent sur des informations attestées en soulignant les zones de spéculation et en dépliant les étapes de leur interprétation. Un paradoxe se dégage tout particulièrement des contributions qui s’attachent à la visualisation des lieux et objets du passé, à savoir que plus la réalisation est convaincante, plus le besoin de documentation est pressant, tant la communication par l’infographie a le potentiel de court-circuiter la déontologie de la recherche scientifique par le biais d’un mimétisme séduisant mais dépourvu de référent historique.
***
Ce livre propose différents formats à même de rendre compte des recherches récentes et expérimentales menées par des collègues à l’international. Les contributions donnent une large place à l’image et à la vidéo pour que les lecteurs et lectrices puissent suivre visuellement les démonstrations. Enrichies de plus de cent images, ces Nouvelles études sur les lieux de spectacle de la première modernité ont ainsi été pensées pour le support numérique, qui seul permet de nos jours une communication multimédia fluide. La publication en accès ouvert (open access), dans la collection Saint Andrews Studies in French History and Culture, d’un volume conçu pour profiter des affordances d’un livre numérique natif – publié simultanément dans une belle version imprimée – reflète reflète également une volonté de décloisonner les recherches spécialisées afin d’élargir le cercle de lecteurs et poursuivre les discussions.
Nous avons fait le choix d’organiser les études autour de quatre thématiques qui invitent à explorer les problématiques soulevées sous différents angles. Les premiers chapitres envisagent le lieu de spectacle dans son rapport étroit à la performance. Cyril Triolaire retrace les étapes de la reconstitution virtuelle du théâtre de Clermont-Ferrand au service d’une création contemporaine, alors que François Rémond appuie son analyse de la scène du théâtre de l'Hôtel de Bourgogne au XVIIe siècle sur des hypothèses infographiques. Raphaël Bortolotti étudie méticuleusement les décors existants du théâtre de Feltre, en Italie, afin de préparer une hypothétique reconstitution numérique de ces objets qui, comme les images informatiques, sont des mélanges de création artistique et technique mis au service d’une illusion. La deuxième partie poursuit ces réflexions, troquant la matrice de la performance scénique pour explorer les archives des lieux de spectacle du passé qui échappent aux récits historiques canoniques dans deux chapitres qui reprennent le concept du virtuel en dehors d’une réalisation numérique. Pour Bertrand Porot, il est question de revenir sur les terrains exploités par le couple Vonderbeck-Godefroy, qui dirigeait une entreprise foraine sans pareille au début du XVIIIe siècle, dont il ne reste plus de traces matérielles. Magaly Piquart-Vesperini détaille les enquêtes qu’elle mène afin d’écrire l’histoire des architectures éphémères des wauxhalls parisiens au XVIIIe siècle. Autre exemple de la manière dont l’étude des lieux de spectacle permet de réécrire l’histoire culturelle même de la capitale en imaginant les dimensions sociales et esthétiques d’espaces dont la disparition physique contribue à leur minorisation dans le récit historique. Entre ces deux contributions, nous intégrons une première « brève de méthodologie ». Ce format tout à fait particulier permet à Paul François de présenter, à l’appui de cinq images, les protocoles et les résultats de la restitution spatiale du projet scientifique VESPACE. Il montre à quel point la restitution virtuelle s’appuie sur l’analyse de sources souvent opposées (plans techniques et peintures) pour étayer l’interopérabilité d’une méthode pluridisciplinaire.
Le troisième temps de l’ouvrage donne une place centrale aux enjeux pédagogiques qui sous-tendent nombre des études sur les lieux de spectacle, un champ de recherche où les méthodes et concepts du virtuel se sont révélés particulièrement efficaces. Le premier article expose le contexte et les recherches du projet ARCHAS, porté par Estelle Doudet et Natalia Wawrzyniak à l’université de Lausanne, qui utilise la modélisation du lieu de spectacle et la RV afin de canaliser l’expérience des étudiants dans une recherche sur les textes théâtraux et le jeu corporel de la fin du Moyen Âge. Le virtuel permet une entrée dans la fabrique de l’objet artistique, confère une épaisseur à des textes, à des gestes et des musiques, et donne un accès sensible et rapide à des savoirs du passé. Ensuite l’architecte Rafaël Magrou rend compte, sous forme d’une seconde « brève de méthodologie », du workshop mené avec des étudiantes en architecture sur le « Vieux Théâtre » de Morlaix, où la technologie permet de restituer un passé menacé de destruction matérielle. Cette partie se clôt par un entretien avec Sandrine Dubouilh, architecte DPLG, professeure en études théâtrales, et l’historien du contemporain Nicolas Patin, sur leur expérience commune d’une séance de Montaigne in Game, un projet pédagogique qui utilise des jeux vidéo (et notamment la série Assassin’s Creed, dont le monde informatique est créé en consultation avec des historiens) pour explorer, expérimenter et interroger la vision de l’histoire véhiculée par ces divertissements ultra-populaires14. Ce dialogue met en valeur deux aspects importants du virtuel pour l’étude historique, qui sert à la fois de lieu de rencontre entre disciplines, et entre le temps historique et le temps de l’historien. La vertu du virtuel est de nous sortir de notre zone de confort, mais aussi de nous laisser porter par l’inattendu et le contre-intuitif qui ne manquent pas d’apparaître chaque fois qu’on réexamine de manière critique des objets, des époques et des phénomènes que nous croyions bien connaître. Dans tous ces projets, les questions éthiques sur la puissance de l’illusion (et pour ARCHAS et Montaigne in Game, l’engouement de pouvoir infléchir la narration en jouant un personnage, une perspective à la première personne qui caractérise la modalité vidéoludique15) accompagnent la réflexion critique sur la transmission des savoirs à des générations qui acceptent plus facilement la « vérité » de l’image numérique.
La dernière section de l’ouvrage donne une place visible à des lieux oubliés, à des espaces qui appartiennent au possible. Nous invitons les lecteurs et lectrices à y entrer par une exposition virtuelle conçue par Louise de Sédouy mettant en valeur des recherches sur un faisceau de théâtres non-aboutis à Bordeaux : vingt images de projets utopiques, fantaisistes, innovants et diversement impossibles qui montrent à quel point le développement d’une ville moderne en France est rythmé de propositions de lieux de spectacle, dont chacun aurait changé l’image de la ville. Non seulement ces images témoignent d’un goût pour le spectacle, mais elles nous laissent aussi imaginer d’autres avenirs possibles, et nous interrogent sur la tendance à réduire l’histoire à ce qui a été fait et dit, construit et détruit. Cette réflexion sur des passés urbains alternatifs se prolonge dans les articles de Julien Le Goff, de Logan Connors et de Jeffrey Leichman et Shea Trahan. Le Goff étudie des projets non-aboutis à Nantes, effacés par la construction bien réelle du théâtre Graslin, exposant l’évolution de la pensée d’une autorité civile désireuse de doter la ville d’une salle de spectacle digne de sa nouvelle richesse commerçante. Connors s’intéresse pour sa part à l’impact d’une expérience théâtrale virtuelle (conçue à partir du projet d’un espace pour les spectacles jamais construit) dans la ville militarisée de Brest, et à la manière dont elle permet d’évaluer et d’analyser les rouages administratifs à l’œuvre dans les relations entre militaires, administration royale et édiles urbains. Leichman et Trahan offrent une modélisation numérique d’une immense salle de spectacle projetée sur les bords du Mississipi à La Nouvelle-Orléans en 1805 par l’architecte Jean-Hyacinthe Laclotte. Dans les trois cas, le bâtiment théâtral apparaît comme une potentialité de l’espace urbain qui répond aux besoins politiques et sociaux autant voire plus qu’esthétiques, et dont il est essentiel de comprendre l’existence virtuelle – celle d’une idée qui ne se réalisera jamais – afin d’apprécier pleinement la signification des structures historiquement attestées. Les lieux non aboutis révèlent clairement la circulation des imaginaires urbains et l’importance des lieux culturels dans la construction de la cité occidentale.
Le volume s’achève sur un entretien conclusif avec Françoise Rubellin, professeure de littérature française du XVIIIe siècle et directrice de plusieurs projets numériques sur l’histoire des spectacles de la Foire et de la Comédie-Italienne, et son collaborateur Olivier Aubert, maître de conférences associé en informatique. Leur conversation invite à réfléchir – à l’instar des études qui la précèdent – à l’impact des outils numériques sur la conception du lieu, de l’histoire et de la recherche en sciences humaines et sociales, ainsi que sur la construction de notre réalité actuelle (durabilité, écologie). En guise de conclusion, nous offrons ainsi une ouverture à de futures conversations et études qui confrontent les technologies de pointe et les positionnements épistémologiques renouvelés aux objets de recherche historiquement éloignés, afin de redécouvrir la pluralité de nos passés et le potentiel de notre présent.
1 Sandrine Dubouilh, « Le lieu théâtral comme objet de recherche : enjeux, méthodes et perspectives », Horizons/théâtre, no 15, 2022 ; Pauline Beaucé, Dubouilh, Cyril Triolaire (dir.), Les espaces du spectacle vivant dans la ville : permanences, mutations, hybridité (XVIIIe–XXIe s.), Clermont-Ferrand, Presses universitaires Blaise-Pascal, 2021.
2 Quelques références sans prétendre à l’exhaustivité : Anne Surgers, Scénographies du théâtre occidental, Paris, Armand Colin, 2000 ; Charles Mazouer (dir.), Les lieux de spectacle dans l’Europe du XVIIe siècle, Tübingen, Gunter Narr, 2006 ; Marvin Carlson, Places of Performance: The Semiotics of Theatre Architecture, Ithaca, Cornell University Press, 1989 ; Gay McCauley, Space in Performance: Making Meaning in Theatre, Ann Arbor, University of Michigan Press, 1999 ; Pannill Camp, The First Frame: Theatre Space in Enlightenment France, Cambridge, Cambridge University Press, 2014 ; Joanne Tompkins, Theatre’s Heterotopias: Space and the Analysis of Performance, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2014 ; Juliet Rufford, Theatre & Architecture, Londres, Macmillan Education UK, 2015 ; Michèle Sajous d’Oria, Bleu et or : la scène et la salle en France au temps des Lumières, Paris, CNRS Éditions, 2007 ; Yuji Nawata et Hans Joachim Dethlefs (dir.), Performance Spaces and Stage Technologies: A Comparative Perspective on Theatre History, Transcript Publishing, 2022, https://doi.org/10.1515/9783839461129 ; Jan Clarke, The Guénégaud Theatre in Paris (1673–1680). Volume One: Founding, Design and Production, Lewiston-Queenston-Lampeter, The Edwin Mellen Press, 1998.
3 Parmi les nombreux projets visant à mêler réalité virtuelle, modélisation 3D et création artistique citons le récent projet ARTECH (2023–2025) né d’un partenariat entre le Théâtre du Chatelet, la plateforme de réalité virtuelle VRtuoz et l’école d’ingénieurs des sciences et technologies numériques Télécom Sud Paris, https://www.telecom-sudparis.eu/wp-content/uploads/2023/05/Communique%CC%81-de-presse-projet-ARTECH-Vf.pdf.
4 Jeffrey M. Leichman, « Depth Match: History, Theatre and Digital Games », The Eighteenth Century, vol. 62, no 1, 2021, p. 1–20; id., « Game Never Over: Replaying History in Interactive Digital Simulation », L’Esprit Créateur, vol. 62, no 2, été 2022, p. 62–74.
5 John Golder, « The Théâtre du Marais in 1644: A New Look at the Old Evidence Concerning France’s Second Public Theatre », Theatre Survey, vol. 25, no 2, novembre 1984, p. 127–152.
6 Voir Jan Clarke, « L’Hôtel Guénégaud selon un croquis inédit », Papers on French Seventeenth-Century Literature, vol. 45, no 88, 2018, p. 159–179.
7 L’iconographie théâtrale est aussi bien entendu utilisée pour la recherche sur les techniques d’interprétation, voir David Wiles, « Seeing is Believing: The Historian’s Use of Images », dans Charlotte Canning et Thomas Postlewaite (dir.), Representing the Past: Essays in Performance Historiography, Iowa City, University of Iowa Press, 2010 ; Sajous d’Oria et Pierre Rosenberg (dir.), Le dessin et les arts du spectacle. vol. 2, Le geste et l’espace II, Villeneuve-l’Archevêque, L’Échelle de Jacob, 2019.
8 Plus largement sur les difficultés du travail en iconographie théâtrale on relira les travaux de Martine de Rougemont et l’article fondateur de Christopher Balme, « Interpreting the Pictorial Record: Theatre Iconography and the Referential Dilemma », Theatre Research International, vol. 22, no 3, 1997, p. 190–201. Voir aussi Clarke, « Problematic Images: Some Pitfalls Associated with the Use of Iconography in Seventeenth-Century French Theatre History », Theatre Journal, vol. 69, no 4, 2017, p. 535–553, https://www.jstor.org/stable/48560826 (consulté le 30 juin 2023) ; Guy Spielmann, « Problématique de l’iconographie des spectacles sous l’Ancien Régime : une étude de cas à partir des frontispices du Théâtre de la Foire (1721–1737) », Revue d’histoire du théâtre, no 237, 2008, p. 77–86 ; Julie Anne Plax, « Theatrical Imagery and Visual Conventions », Actes du 2d colloque international Cesar, https://cesar.huma-num.fr/cesar2/conferences/cesar_conference_2006/confintro.html (consulté le 4 juillet 2023).
9 Le théâtre en province sous la Révolution et l’Empire : salles et itinérance, construction des carrières, réception des répertoires, dir. par Philippe Bourdin, CHEC, Université Clermont Auvergne.
10 En plus du site, les porteurs de ce projet ont publié un ouvrage : Tompkins, Julie Holledge, Jonathan Bollen et Liyang Xia, Visualising Lost Theatres. Virtual Praxis and the Recovery of Performance Spaces, Cambridge, Cambridge University Press, 2022.
11 The LAB 18–21 (Théâtre et lieux de spectacle à Bordeaux XVIIIe–XXIe siècles), projet financé par la PSE de l’université Bordeaux Montaigne (2018–2020) et porté par Beaucé et Dubouilh ; RECREATIS (Recréer en réalité virtuelle : architecture et théâtres inaboutis), projet financé par la MSH de Nantes et porté par Françoise Rubellin et Laurent Lescop.
12 Il serait difficile de l’être vu le nombre de projets et la diversité des périodes qu’ils recouvrent. Citons pour le théâtre antique les travaux de Sophie Madeleine, directrice du Centre interdisciplinaire de réalité virtuelle (Le théâtre de Pompée à Rome. Restitution de l’architecture et des systèmes mécaniques, Caen, Presses universitaires de Caen, 2014), le projet de restitution des théâtres oubliés de Dublin au XXe siècle (Hugh Denard et Freya Clare Smith, https://lost-theatres.net) ou encore celui du Palais-Royal au temps de Molière et Lully (carnet de recherche de l’historienne de l’art Gaëlle Lafage, https://moliere.hypotheses.org).
13 Yann Rocher, Théâtres en utopie, Paris, Actes Sud, 2014 ; Pierre Singaravélou et Quentin Deluermoz, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus, Paris, Seuil, 2016.
14 Chaîne YouTube du projet : https://www.youtube.com/channel/UCFDO48aiMSBxBXwTMbwuaEg (consulté le 2 juillet 2023).
15 L’analyse désormais classique d’Espen Aarseth propose la catégorie de « littérature ergodique » comme un genre qui exige un effort non-trivial de la part du lecteur afin de traverser le récit, situant le jeu vidéo dans l’évolution d’oeuvres narratives interactives dont la compréhension est dépendante des actions entreprises par l’individu au moment de la lecture (Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature, Baltimore, Johns Hopkins Press, 1997).